11/11/2017
Cris de Laurent Gaudé
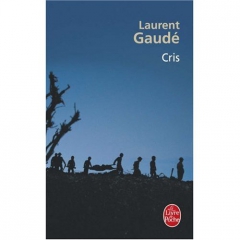
Cris de Laurent Gaudé, Le livre de poche, 2005[2001], 181p.
Je me demande bien quel visage a le monstre qui est là-haut qui se fait appeler Dieu, et combien de doigts il a à chaque main pour pouvoir compter autant de morts.
Quelques soldats au quotidien dans l'enfer des tranchées, un gazé qui agonise déjà oublié de tous, un sauvageon mi-homme mi-bête qui terrorise les vivants et les morts, un jeune homme en permission en partance pour Paris: en somme, rien que de très attendu pour un roman sur la Première Guerre Mondiale.
Il faut pourtant ajouter à cela, qui est évidemment vrai et vous résume - de manière bien superficielle - le propos de Cris, qu'il s'agit du premier roman de Laurent Gaudé. Par conséquent, au-delà d'un récit factuel, d'une peinture plus vraie que nature, il serait plus juste de dire qu'il donne voix, qu'il donne cris à ses personnages qui prennent la parole en de fulgurants monologues comme autant de chants païens poussés à la face d'un monde en déliquescence. Enfermés dans leur corps presque-déjà-mort, s'attachant sauvagement à ce qu'il leur reste de vie, de souffle, de hargne, ils forment tous une communauté étonnamment soudée au-delà des mots impossibles. Ils se rejoignent tous d'une manière ou d'une autre. La plongée que propose Gaudé dans ces intériorités coupées de tous, profondément torturées, démentes, humaines, est sans doute une des plus intéressantes manières de nous donner à ressentir une expérience aussi limite et indicible que celle de la guerre. Il faut accepter du coup, d'aller d'un personnage à l'autre en des phrases courtes, lapidaires, parfois averbales. Bien que le style puisse dérouter, il participe à la nécessaire aridité du propos.
Et puis, sorti des tranchées, il y a Jules, qui ouvre et ferme systématiquement les cinq parties de ce roman comme autant d'actes tragiques. Jules, celui qui s'en va pour mieux revenir, qui connaît l’ambiguïté de sentiments qu'implique une permission : joie, angoisse, dégoût, plaisir, indifférence, rejet. Jules, à mesure du récit, se sent habité d'un devoir de transmission. Cette permission doit permettre de dire, de faire comprendre la guerre. Il tentera le discours frontal et essuiera un cuisant échec. Puis il tentera la voie de l'art. Dans tout ce cauchemar, c'est l'art qui purge, lave, apprend, transcende. Mine de rien, on en revient au théâtre cathartique. Ou, plus justement, on atteint ici le talent de Laurent Gaudé, qui ne s'est pas démenti depuis, de créer un pont subtil et passionnant entre l'art du roman et celui du théâtre.
Je cours maintenant. Je sais où je vais. J’ai compris ce que voulait le gazé. Je voudrais lui dire qu’il peut se rassurer. J’ai enfin compris ce qu’ils veulent, tous ceux qui me parlent à voix basse. Je vais me mettre à l’œuvre. [...]
Tous les carrefours. Toutes les places. Le long des routes. À l’entrée des villages. Partout. Je ferai naître des statues immobiles. Elles montreront leurs silhouettes décharnées. Le dos voûté. Les mains nouées. Ouvrant de grands yeux sur le monde qu’elles quittent. Pleurant de toute leur bouche leurs années de vie et leurs souvenirs passés. Je ne parlerai plus. La pluie de pierres m’a fait taire à jamais. Mais un à un, je vais modeler cette colonne d’ombres. Je les disperse dans les campagnes. C’est mon armée. L’armée qui revient du front et demande où est la vie passée. Je ne parlerai plus. Je vais travailler. J’ai des routes entières à peupler. À chaque statue que je finis, la voix qui me hante se tait. Ils savent maintenant que je suis les mains de la terre et qu’ils ne mourront pas sans que je leur donne un visage. Ils savent maintenant qu’ils n’ont pas besoin de cri pour être entendus. Une à une les voix s’apaisent. Mais il en revient toujours. C’est une vague immense que rien ne peut endiguer. Je leur ferai à tous une stèle vagabonde. Je donne vie, un par un, à un peuple pétrifié. J’offre aux regards ces visages de cratère et ces corps tailladés. Les hommes découvrent au coin des rues ces grands amas venus d’une terre où l’on meurt. Ils déposent à leur pied des couronnes de fleurs ou des larmes de pitié. Et mes frères des tranchées savent qu’il est ici des statues qui fixent le monde de toute leur douleur. Bouche bée.
19:56 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : première guerre mondiale, tranchées, voix, cris, laurent gaudé, roman, théâtre, monologue, transmission, guérison, art
04/02/2017
Le Garçon de Marcus Malte
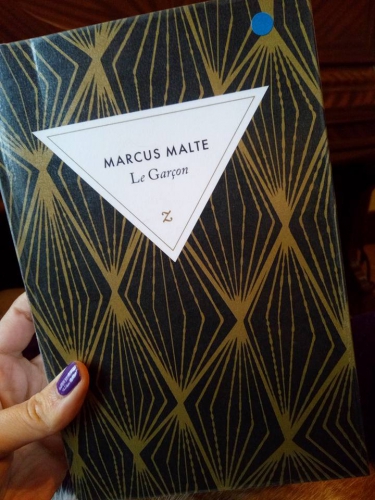
Même l’invisible et l’immatériel ont un nom, mais lui n’en a pas. Du moins n’est-il inscrit nulle part, sur aucun registre ni aucun acte officiel que ce soit. Pas davantage au fond de la mémoire d’un curé d’une quelconque paroisse. Son véritable nom. Son patronyme initial. Il n’est pas dit qu’il en ait jamais possédé un. Plus tard, au cours de l'histoire, une femme qui sera pour lui sœur, amante et mère, lui fera don du sien, auquel elle accolera en hommage le prénom d'un célèbre musicien qu'elle chérissait entre tous. Il portera également un nom de guerre, attribué à l'occasion par les autorités militaires en même temps que sa tenue réglementaire d'assassin. Ainsi l'amour et son contraire l'auront baptisé chacun à sa façon. Mais il n'en reste rien. Ces succédanés aussi seront voués à disparaître à la suite de cette femme et de cette guerre et de l'ensemble du monde déjà ancien auquel elles avaient pris part. p. 8
J'ai beau ne pas beaucoup verser dans la brûlante actualité littéraire présentement, je n'ai pas su résister à l'appel de ce roman à force de chroniques élogieuses chez bien des blogueuses que j'apprécie. Et voilà qu'au détour d'un rayon de la médiathèque, il était là, qui m'attendait. Un des rares romans de la rentrée littéraire encore sur sa table d'exposition : il fallait que ce soit celui-ci ! Ce fut un signe comme un autre. Qu'à cela ne tienne ! Garçon, me voilà !
Toute première page et première impression : quel incipit ! Poétique, mystérieux, total. En un moment : éblouissant. Il ne m'en faut pas plus pour plonger tête baissée dans le récit et découvrir cette atmosphère que j'aime tant, que j'avais déjà savourée chez Garcia Marquez ou chez Sylvie Germain (différemment mais toujours sublime) - un mélange savoureux d'âpreté très réaliste et de magie toute lumineuse. Le Garçon, c'est de bout en bout ce tourbillon incongru des saveurs, épicé, acide ou brûlant.
Nous ne saurons jamais qui est le garçon. Tel un personnage de conte - la vie n'est-elle pas un conte lorsqu'on l'envisage avec de la hauteur et sous la bonne lumière ? - il évolue sans véritable identité. Il est cet être sans visage, sans traits très définis, qui pourrait être n'importe qui et campe pourtant, solide, un physique que l'on ressent puissant et très tendre. A mesure de son périple dans la vie, dans le monde, dans les villages de France et de Navarre, le garçon apprend à être un homme - ce que sa mère, avec qui il vivait jusqu'ici reclus, en Perceval moderne, avait omis de lui enseigner. La présence même de l'autre lui était jusqu'ici inconnue. Il apprend à côtoyer ses semblables donc, se sentant appelé par l'humanité comme un loup par sa meute. Les débuts sont difficiles : l'autre n'est pas toujours tendre. Il fait l'expérience du labeur, des moqueries et plus que tout, de la mort qui défait inlassablement les liens doucettement créés.
C'est un temps de mue. Corps et âme. Les poils chassent le duvet et la lucidité déchire de ses griffes acérées le voile de l'innocence - et la voilà qui pointe à travers les lambeaux son triste museau d'huissier. on peut en prendre le pari. assis le soir le regard dans le feu et les lèvres qui ânonnent en silence. C'est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas, constituée l'existence : nombre de ravages et quelques ravissements. p. 174
Et voilà qu'au détour d'un chemin, c'est la rencontre suprême, l'éclair, l'accident : l'amour ! C'est cette voiture qui envoie valser sa roulotte solitaire et le garçon, blessé, est recueilli par un vieux père et sa fille. Elle le soigne, elle lui joue encore et encore du piano comme elle lui chanterait son affection d'abord, puis sa passion. Le garçon, jusqu'ici, avait appris à être un homme. Il apprend à présent à être amant. Au passage, et subtilement, Marcus Malte transforme son verbe en une prose libertine, plus cinglante, plus humide qu'auparavant, non sans conserver le pouvoir d'emporter le lecteur avec une fougue impressionnante.
Pores, poils, pulpe alimentent le feu. L'esprit encense, le sang bouillonne et les humeurs coulent, s'expriment, diffusent à l'envi. Le décor varie mais c'est leur corps qui est le vrai théâtre de leur concupiscence. p.262
Voyage, amour : et puis la mort. On le sait dès le départ, comme dirait Ferré, il faudra qu'il y ait le guerre. On le sait bien. Et dans tout ce récit intemporel, qui pourrait être n'importe quand, voilà que la guerre marque le temps fatalement, irrémédiablement. Tranchées, obus, boucherie. On sait où le garçon s'en est allé, on sait dans quel marasme il a perdu un peu de son âme. Le style devient visqueux, puant - d'une sensorialité prégnante à l'image de ce qu'a dû être le quotidien des Poilus. De longues et terribles phrases s'enroulent autour du lecteur, on étouffe, on voudrait en sortir - quand les phrases ne se font pas soudain courtes pour devenir gifles. Mais puisque le garçon tient, on poursuit, on ne plie pas sous la virtuosité des mots, on marche nous aussi sur les sentiers, on court aussi sous la mitraille, on enfonce aussi la lame dans le cou de l'ennemi.
Et maintenant ils marchent.
C'est un pays de labours. Un pays de fermes, de villages, de blé, de vignes, de vaches, d'églises. C'est un pays de pis et de saints. C'était. La magie de la guerre. Qui tout transforme, hommes et relief. Mets un casque sur le crâne d'un boulanger et ça devient un soldat. Mets un aigle sur son casque et ça devient un ennemi. Sème, plante des graines d'acier dans un champ de betteraves et ça devient un charnier. Plus fort que W. C. Harding. Plus vaste. Le grand cirque, la caravane. La parade monstre.
Ils marchent. p. 355
De tout ça, que reste-t-il ? J'aimerais pouvoir me souvenir de bien plus, être capable de réciter des passages entiers. La mémoire est toujours bien défaillante au regard d'un livre qu'on a aimé ! Je conserve pourtant l'essentiel, probablement : cette certitude d'avoir vécu un sacré beau voyage comme la littérature de talent en a le secret. D'avoir touché du doigt et des yeux une vie pleine, entière, ronde comme un perle rare ; subtile et ombreuse comme l'est toute vie de chair et d'os.
- Les gens du voyage, dit Brabek. C'est ainsi qu'on les nomme. Mais au bout du compte, est-ce que nous ne sommes pas tous du voyage ? p. 163
Le Garçon de Marcus Malte, Zulma, 2016, 535p.

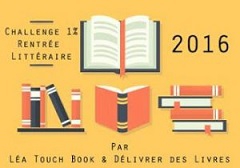 Challenge rentrée littéraire 2016 chez Hérisson
Challenge rentrée littéraire 2016 chez Hérisson
3ème participation
20:13 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : le garçon, marcus malte, amour, vie, voyage, humanité, nom, guerre, première guerre mondiale, talent, chef d'oeuvre, coup de coeur
11/11/2016
Le collier rouge de Jean-Christophe Rufin

Le collier rouge de Jean-Christophe Rufin, Gallimard, 2014, 156p.
En plein cœur de l'été, un cabot fait des siennes et hurle jour et nuit, ce qui n'est pas sans rendre fou le gardien de la caserne juste en face, Dujeux. Ce dernier ne garde qu'un seul prisonnier puisqu'en 1919, tout le monde est rentré chez soi : L'énigmatique Morlac, plutôt taiseux et taciturne, et plutôt réfractaire à accepter l'indulgence du juge Lantier venu l'interroger. Tout se joue, dans les premiers temps du récit, entre ces deux-là (Dujeux fait seulement partie du décor) et le chien qui rythme questions et réponses et semble, à distance, répondre à son maître enfermé. Nous ne savons pas grand chose, alors. Nous sommes à l'image de Lantier : nous cherchons à comprendre ce que Morlac fait là, pourquoi il se complait dans une opposition si farouche et, pourquoi, surtout, il refuse l'affection si démonstrative du chien.
A mesure que l'histoire se déroule, entre les tranchées, les morts, et la solitude, un troisième personnage crucial apparaît : Valentine (Cherchez la femme, qu'ils disaient, cherchez la femme !). Tout n'est donc pas qu'une histoire de guerre, finalement. C'est plus complexe, et pourtant très simple.
Au premier abord, j'ai trouvé Le collier rouge d'une grande finesse, d'une maîtrise évidemment totale (sans avoir jamais lu Rufin auparavant, c'est tout à fait le genre de style auquel je m'attendais) mais d'une finesse et d'une maîtrise finalement un peu froides, un peu sèches - oserais-je dire un peu plates? Je me retrouvais exactement avec le même sentiment de lecture que 14 d'Echenoz (si mon souvenir est exact). J'avançais donc, dubitative, dans l'attente de quelque chose : de ressentir, plutôt que de penser, je crois.
Puis, finalement, je me suis prise au jeu de frayer dans les pas de Lantier. Sans être du tout un policier - on est même loin du compte -, la construction est habile, et joue à nous dévoiler les informations au compte-goutte, en commençant évidemment par les plus anecdotiques pour monter progressivement en puissance, en intérêt, en curiosité. Les personnages prennent du relief et se colorent de toute l'ambivalence de l'humanité (exception faite, peut-être, de Dujeux et du gendarme local qui représentent le petit fonctionnaire dans toute la splendeur de sa bêtise fatiguée mais heureuse).
Rufin aborde la Première Guerre Mondiale sous un autre angle : la voilà finie. Les tranchées ne sont plus là, effectivement, mais fourragent encore dans les esprits avec une puissance lancinante. L'après semble aussi lourd que le pendant - pas de la même façon, pas avec autant de terreur bien sûr, mais il pèse durablement. L'après sonne aux oreilles de Morlac comme une vaste mascarade laissant entrevoir que personne n'a compris l'essence de la guerre et qu'être un héros n'a rien de reluisant. C'est d'une tristesse infinie d'être un héros. Et voilà que je me surprends à méditer encore, mine de rien, le message tout simple et si crucial de Rufin. Finalement, elles valaient sacrément le coup, cette grande finesse et cette maîtrise totale.
C'était lui, le héros. C'est ça que j'ai pensé, voyez-vous. Pas seulement parce qu'il m'avait suivi au front et qu'il avait été blessé. Non, c'était plus profond, plus radical. Il avait toutes les qualités qu'on attendait d'un soldat. Il était loyal jusqu'à la mort, courageux, sans pitié envers les ennemis. Pour lui, le monde était fait de bons et de méchants. Il y avait un mot pour dire ça : il n'avait aucune humanité. Bien sûr, c'était un chien... Mais nous qui n'étions pas des chiens, on nous demandait la même chose. Les distinctions, médailles, citations, avancements, tout cela était fait pour récompenser des actes de bêtes. p. 121
09:43 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : jean-christophe rufin, le collier rouge, première guerre mondiale, héros, légion d'honneur




